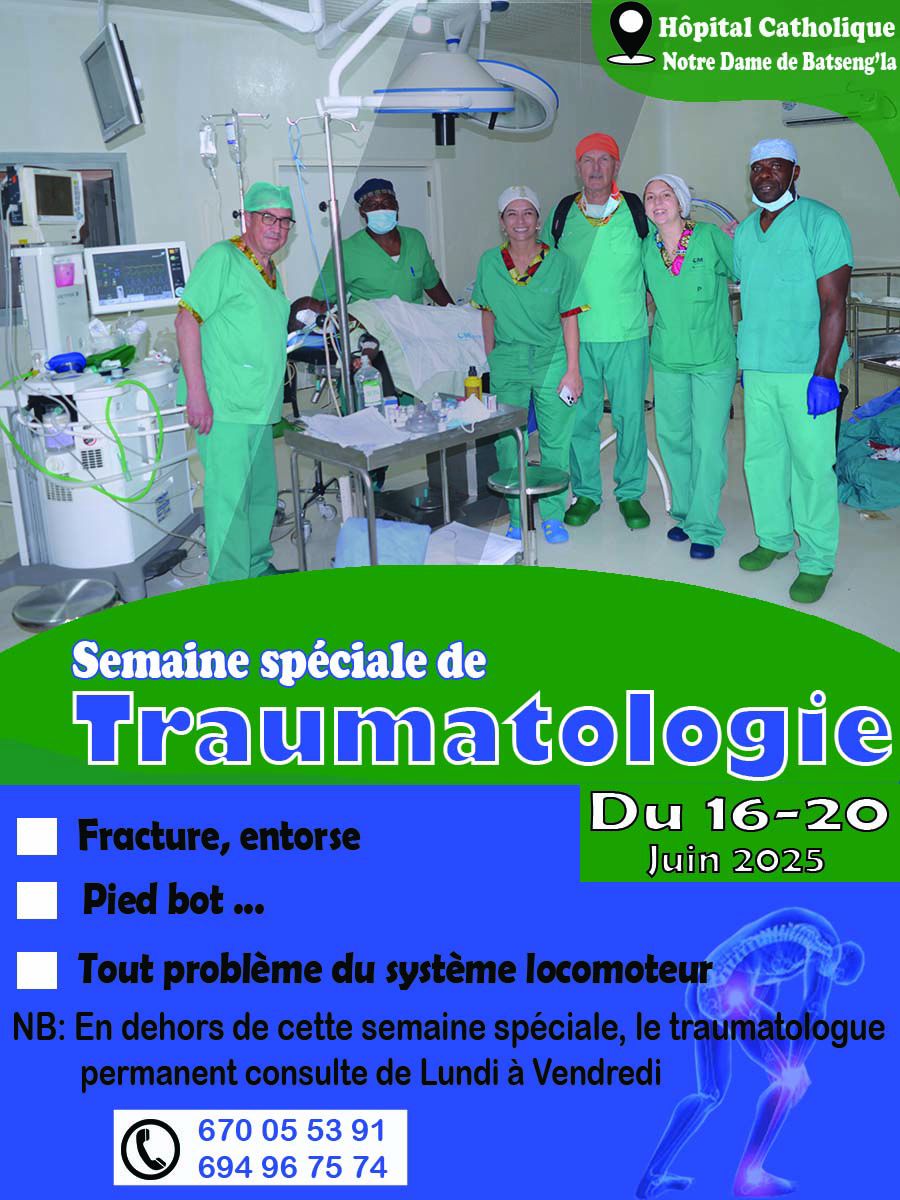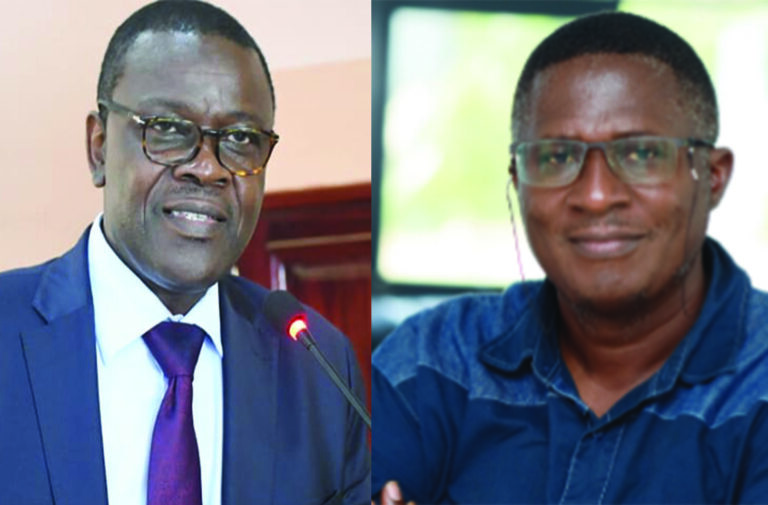Le riz est l’une des denrées alimentaires qui met l’économie camerounaise à genoux et contribue fortement au déficit de sa balance commerciale. En plus de 50 ans, les politiques agricoles en la matière ont été contre-productives, obligeant les ménages Camerounais à se tourner vers du riz en provenance d’Asie. L’autopsie de ces politiques a été faite par le professeur Jules Kouosseu dans sa leçon inaugurale présentée au cours du colloque international et pluridisciplinaire de l’Association Camerounaise de l’Histoire Économique et Sociale en abrégé Acahes.
Le professeur Jules Kouosseu est enseignant au département d’histoire et archéologie de l’université de Dschang. Le colloque international de l’Acahes a été un prétexte pour le chercheur de présenter les causes évidentes de l’échec de la politique rizicole au Cameroun depuis l’indépendance. Le colloque qui s’est ouvert ce mardi 3 Juin 2025 à l’université de Dschang a pour thème: « Agriculture, ruralité et développement endogène en Afrique coloniale et post-coloniale. »







C’est avec assez de précisions que le professeur Jules Kouosseu revient sur un sujet qui a constitué l’ossature de sa thèse de doctorat intitulée « la riziculture dans la vallée du Logone: des origines à l’an 2000. » L’historien fait savoir que c’est pendant la Deuxième Guerre Mondiale que la culture du riz a été introduite au Cameroun. À l’aube des indépendances, le Cameroun opta pour la création des sociétés parapubliques afin de concrétiser le rêve d’une production nationale suffisante de riz: la Cameroon Development Corporation (CDC), la Société d’Expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yagoua (SEMRY), la Upper Nun Valley Development Authority ( UNVDA) et la Société de Développement de la Riziculture dans la plaine des Mbo (SODERIM). Selon le professeur Kouosseu, l’État du Cameroun, à travers ces sociétés agro-industrilelles opta pour une culture irriguée et mécanisée du riz qui nécessite de gros financements. D’énormes sommes furent alors investis:
- Plus de 80 milliards pour la SEMRY entre 1971 et 1988.
- 7,1 milliards pour la SODERIM qui par ailleurs a été fermée
- 7 milliards pour l’UNVDA de 1981 à 1987.
Des efforts contre-productifs de l’État du Cameroun
En dépit de ces financements massifs, la production cumulée de ces différentes sociétés n’a pu satisfaire la demande intérieure qu’à hauteur de 20% en 1983. La saignée s’est entretenu sur plusieurs décennies et les importations de riz n’ont cessé de grimper. Rien que pour l’année 2024, 318,5 milliards ont été utilisés pour importer du riz. Les financements injectés dans les différentes tentatives de relance de la filière rizicole ne sont toujours pas proportionnels à la réalité sociale.
La politique rizicole au Cameroun et ses choix questionnables.
Selon Jules Kouosseu, l’option d’une riziculture mécanique irriguée a suffisamment montré ses limites. Cependant, l’universitaire renseigne que l’État semble vouloir défoncer une porte ouverte à travers la stratégie de développement de la filière riz adoptée le 16 Mai 2023.

Le coût global de cette nouvelle stratégie est évalué à 385 milliards de FCFA dont 298 milliards pour les périmètres irrigués et 87 milliards pour les autres biens et services. Les fonds devraient être mobilisés auprès des partenaires au développement, du secteur privé et du budget d’investissement public. À l’opposé de cette approche qui semble budgétivore et qui a déjà montré ses faiblesses, le spécialiste en histoire économique propose une riziculture pluviale et celle des bas-fonds. Selon lui, il s’agit d’une approche de riziculture traditionnelle qu peut être expérimentée dans toutes régions du Cameroun. Avec un potentiel national de 2 809 800 hectares de terres irrigables contre seulement 10% du taux d’occupation de ces terres, la riziculture Camerounaise a de beaux jours devant elle à condition que les politiques publiques optent pour des stratégies adaptées aux réalités locales.

Le débat sur le riz n’est en fait que l’un des plats au menu du du colloque international et pluridisciplinaire de l’Association Camerounaise l’Histoire Économique et Sociale en cours à l’université de Dschang. Pendant ces deux jours de réflexion, ces scientifiques produiront d’autres résultats exploitables par les politiques publiques agricoles.
Article rédigé par Valdo SIEWE
Annonces: